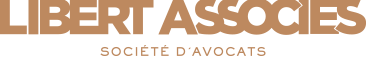- Des mesures anti-abus : il appartiendra désormais au contribuable de démontrer que la détention d’actifs dans des pays ne pratiquant pas l’assistance administrative avec la France ou inscrits sur la liste des États non-coopératifs n’a pas une visée fiscale ;
- Une harmonisation et une simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics (procédures de saisie) ;
- La consolidation du contrôle par l’administration fiscale de la tenue de comptes d’épargne réglementés.
4/ Dispositions sectorielles en lien avec l’actualité gouvernementale
Le projet de loi de finances rectificative comporte enfin plusieurs volets de mesures sectorielles, parmi lesquelles peuvent être soulignées :
- Pour l’éducation : limitation du bénéfice du fonds de soutien au développement des activités périscolaires aux communes ayant fait le choix de sortir de la semaine de quatre jours ;
- Pour le logement : garantie de la bonification, par Action logement, des prêts accordés par le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts ;
- Pour la fiscalité locale : codification des modalités de révision des valeurs locatives des locaux professionnels et report au 1er janvier 2019 de la mise à jour permanente des tarifs des locaux professionnels ;
- Pour le financement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : les sommes avancées par le comité international olympique seront garanties en cas d’annulation des Jeux Olympiques, comme le précédent Gouvernement s’y était engagé. En outre, en complément des 48 millions d’euros de crédits ouverts par le projet de loi de finances, il est prévu un article portant garantie de l’Etat sur les emprunts souscrits par le comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO).
Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’économie et des finances présentent ainsi un collectif de fin de gestion qui confirme les engagements du Gouvernement permettant à la France de renouer avec le sérieux budgétaire. Conformément aux objectifs présentés lors du débat d’orientation des finances publiques, ce texte constitue une nouvelle étape dans la volonté du Gouvernement de réduire, d’ici 2022, la dette de 5 points de PIB, la dépense publique de 3 points, le déficit de 2 points – avec dès cette année le passage sous la barre des 3 % – et les prélèvements obligatoires d’un point.
Exception à l’immunité du commissaire aux comptes dans la révélation de faits délictueux au procureur de la République
Si la révélation au procureur de la République par un commissaire aux comptes de faits délictueux ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d’une intention malveillante.
En effet, les faits qui échappent par nature à toute qualification pénale ne peuvent pas constituer le support de révélation du commissaire aux comptes, en particulier, un litige existant entre la société auditée et l’auditeur légal à propos de sa désignation et des honoraires de celui-ci.
Cass. com., 15 mars 2017, n° 14-26.970 (lien)
DROIT SOCIAL
Le Conseil d’entreprise : un CSE avec la capacité de négocier
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en une nouvelle instance unique, le Comité social et économique (CSE). Les entreprises devront le mettre en place lors de leurs prochaines élections professionnelles à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Le CSE offre une option de plus aux partenaires sociaux. Sous condition, il est possible de doter cette nouvelle instance de la capacité de négocier et conclure un accord collectif, auquel cas on parle de « Conseil d’entreprise ».
Un Conseil d’entreprise peut être institué, en lieu et place du comité social et économique (CSE), dans les entreprises avec ou sans délégué syndical ainsi que dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale (UES). À la différence du CSE, le Conseil d’entreprise a la capacité de négocier un accord collectif. Le Conseil d’entreprise étant un dérivé du CSE, il ne pourra donc être créé qu’une fois le CSE opérationnel.
1/ Accord de mise en place d’un Conseil d’entreprise
L’accord de mise en place du Conseil d’entreprise diffère selon l’existence ou non de délégué syndical. Dans les entreprises avec délégué syndical, le Conseil d’entreprise peut être mis en place par accord d’entreprise à durée indéterminée. Dans les entreprises sans délégué syndical, le Conseil d’entreprise peut être mis en place en application d’un accord de branche étendu.
L’accord de mise en place doit comprendre un certain nombre de clauses :
- Les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements ;
- La liste des thèmes soumis à l’avis conforme du Conseil d’entreprise, sachant que la formation doit en faire partie ;
- Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus participant aux négociations qui ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieur à un nombre d’heures fixé par décret à paraître, sachant que le temps passé aux séances de négociation elles-mêmes constitue du temps de travail effectif ;
- Les modalités d’indemnisation des frais de déplacement.
2/ Capacité de conclure et négocier un accord collectif
S’agissant de ses attributions, le Conseil d’entreprise exerce l’ensemble des attributions dévolues au CSE et suit ses règles de fonctionnement. Mais à l’inverse du CSE, le Conseil d’entreprise est un nouvel acteur en matière de négociation collective sans pour autant supprimer le délégué syndical. S’il y a un Conseil d’entreprise, ce dernier est le seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
Pour être valable, l’accord conclu avec un Conseil d’entreprise doit être signé par la majorité des membres titulaires élus du Conseil d’entreprise ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés (plus de 50 %) lors des dernières élections professionnelles.
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (lien)
Possibilité pour l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement dans un délai de 15 jours
En vue d’une réunion exceptionnelle de la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), le 23 novembre prochain, les partenaires sociaux ont reçu plusieurs projets de décret dont l’un concerne la lettre de licenciement. En effet, en application de l’Ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’employeur pourra préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement après sa notification. Le projet de décret fixe les délais et conditions dans lesquels ces précisions pourront être apportées. Le décret serait applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.
Le salarié disposera de 15 jours suivant la notification de son licenciement pour demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre. Il devra le faire, précise le projet de décret, par lettre recommandée avec avis de réception. Quant à l’employeur, il disposerait également d’un délai de 15 jours pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il les communiquera au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge. Dans le même délai et les mêmes formes, l’employeur pourrait, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.