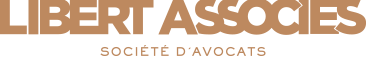DROIT DES AFFAIRES / FISCALITE
Loi PACTE : Création d’un fonds de pérennité économique
La Loi PACTE, publiée au Journal officiel le 23 mai dernier, prévoit la création d’un fonds de pérennité économique, conçu pour être un outil de stabilité de l’actionnariat des entreprises.
L’objectif de cette mesure est de permettre la poursuite du développement économique d’une ou de plusieurs sociétés commerciales dont les parts ou actions seraient apportées au fonds.
Cette structure juridique sera constituée par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
Cet apport sera réalisé par une ou plusieurs personnes, en général les fondateurs, afin que le fonds gère les titres ou parts concernés, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique des sociétés les ayant émis.
Le fonds de pérennité pourra gérer activement les participations apportées en vue d’assurer le développement de l’entreprise sur une longue période, tout en préservant les valeurs que les fondateurs auront inscrites dans les statuts du fonds. Grâce aux ressources tirées de l’entreprise, le fonds pourra réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.
Ce fond de pérennité sera administré par un conseil d’administration
Pour protéger le capital de l’entreprise cédée, les actions qui permettent de la contrôler seront inaliénables.
Loi 2019-486 du 22 mai 2019 : JO 23
Démission d’office d’un administrateur représentant les salariés
Depuis la publication de la Loi PACTE, les sociétés (SA, SCA et SE) qui ont plus de 1.000 salariés en France ou 5.000 salariés en France et à l’étranger doivent prévoir dans leurs statuts la désignation au Conseil d’administration ou de surveillance d’au moins deux représentants des salariés pour 8 administrateurs non-salariés. Ceux-ci doivent être titulaires, depuis au moins deux ans, d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales.
Selon l’ANSA, lorsque la filiale dont un tel administrateur ou membre du conseil de surveillance est salarié cesse de faire partie du groupe à la tête duquel se trouve la société mère, cette situation entraîne la démission d’office de l’intéressé de son mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance car cet administrateur (ou membre du conseil de surveillance) ne remplit plus les conditions de l’article L225-28 du Code de commerce pour représenter les salariés du groupe.
Ainsi, un administrateur qui représente les salariés au conseil d’administration d’une SA en sa qualité de salarié d’une filiale de celle-ci est démissionnaire d’office si la filiale cesse de faire partie du groupe à la tête duquel se trouve la société. L’ANSA estime qu’il y a démission d’office sans qu’il y ait lieu de le préciser dans les statuts.
Il est selon nous opportun de prévoir ce cas de démission d’office dans les statuts.
Communication Ansa, comité juridique n° 19-015 du 6-3-2019
Constitutionalité de la retenue à la source sur les services rémunérés à l’étranger
Conformément aux dispositions de l’article 182 B, I-C du Code général des impôts, les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou à des sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source.
Cette retenue, dont le taux est en principe de 33 1/3 %, est calculée sur l’assiette brute des sommes payées.
Ces dispositions ont été contestées comme instaurant des différences de traitement.
Dans une décision en date du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et sont conformes à la Constitution.
Il retient que si les entreprises non-résidentes sont imposées sur les sommes perçues sans pouvoir déduire de charges, cette différence de traitement avec les entreprises établies en France, imposées sur leurs bénéfices, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi et ne crée pas une différence de traitement injustifiée.
Cons. Const. 24-5-2019 n° 2019-784
DROIT SOCIAL
Réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Trois décrets du 27 mai 2019 mettent en œuvre la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) issu de la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018. Ces textes concernent la déclaration obligatoire et le calcul de la contribution financière.
Les nouvelles règles issues de ces décrets entreront en vigueur le 1er janvier 2020.
Tous les employeurs, y compris ceux occupant moins de 20 salariés, devront déclarer les travailleurs handicapés qu’ils emploient, ce qui permettra de mieux identifier leurs besoins et d’y répondre plus efficacement. Toutefois, seuls les employeurs de 20 salariés et plus seront assujettis à l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés et devront verser une contribution en cas de non-atteinte de cet objectif, comme actuellement.
L’effectif annuel pris en compte pour l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sera calculé en tenant compte de la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
En outre, l’unité d’assujettissement ne sera plus l’établissement mais l’entreprise. Cela signifie que si une entreprise possède plusieurs établissements, l’obligation d’emploi ne s’applique plus à chaque établissement individuellement mais à la somme des effectifs de chacun des établissements faisant partie de l’entreprise.
Ainsi, tout travailleur handicapé, quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD, intérimaire, stage, période de mise en situation en milieu professionnel) sera comptabilisé au prorata de son temps de travail.
Enfin, en cas de non-respect de l’OETH, le décret fixe le barème de calcul de la contribution des entreprises n’atteignant pas le taux obligatoire d’emploi de travailleurs handicapés en fonction de leurs effectifs.
n° 2019-521, 2019-522 et 2019-523 du 27 mai 2019, JO 28 mai
DROIT DES ASSURANCES
L’aide bénévole apportée à une victime ne doit pas profiter au responsable de la situation
Dans une décision en date du 22 mai 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’aide bénévole apportée par un proche après un accident ne doit pas bénéficier au responsable de cette situation et ne doit pas réduire les indemnités versées par ce dernier.
En l’espèce, après avoir reçu des soins orthodontiques, une patiente a présenté différents troubles qui ont notamment entraîné une diminution de ses capacités professionnelles. Son conjoint l’avait alors aidé bénévolement. L’assureur du responsable estimait qu’il n’avait rien à verser à ce titre, d’une part parce que le patient n’avait pas fait de dépenses pour être aidé et d’autre part parce que la seule personne qui ait fourni un effort était le conjoint bénévole, lequel n’avait aucun lien avec le médecin fautif et ne pouvait donc rien lui réclamer.
La Cour d’appel de Lyon, dans une décision en date du 11 janvier 2018, fait droit aux demandes de l’assureur du responsable de la situation.
La Cour de cassation censure la décision d’appel. Elle estime que l’indemnisation est due en fonction du besoin de la victime et celui qui la doit n’a pas à contrôler quelle forme a prise l’aide ou quel coût elle a finalement engendré.
Cette victime avait donc un préjudice que le responsable devait assumer sans avoir à réclamer une preuve de dépenses effectives faites à ce titre.